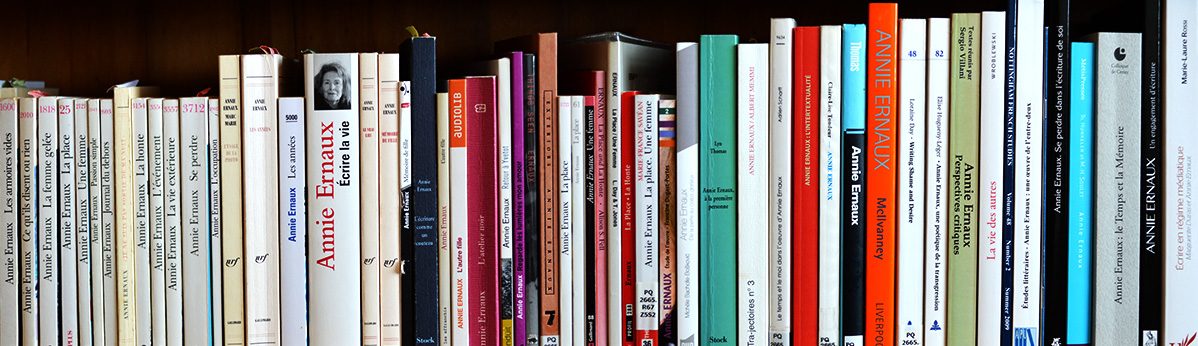Annie Ernaux a vécu toute son enfance et son adolescence à Yvetot en Normandie, où ses parents tenaient un café-épicerie dans un quartier ouvrier. Elle a mené une carrière d’enseignante et publié une vingtaine de livres, dont La Place et Les Années. Elle vit depuis 1975 à Cergy.
C’est le hasard d’une émission de télévision programmée l’après-midi pour les femmes « au foyer » – c’est ainsi qu’on dit toujours en 1981 – intitulée « Aujourd’hui Madame » que j’ai rencontré Claude pour la première fois. Une émission un brin guindée, enregistrée à l’avance. Nous sommes là tous les deux pour parler de nos livres qui viennent de sortir avec des lectrices, qui les ont lus. Je connais Claude Duneton, il est célèbre depuis Je suis comme une truie qui doute que, bizarrement, je n’ai pas lu alors que je suis prof et que, comme je le découvrirai ensuite, je partage entièrement son constat sur l’enseignement. Je lui suis inconnue, c’est normal, j’ai peu publié en sept ans et s’il fallait lire tout ce qui sort… Là, nous sommes censés avoir au moins parcouru le livre de l’autre. Celui de Claude s’appelle Le Diable sans porte, c’est le premier tome d’une autobiographie et il l’a intitulé Ah ! mes aïeux ! Le mien est aussi une autobiographie mais masquée sous le mot « roman », qui ne trompe personne, La Femme gelée. Donc, quand l’émission commence, l’un et l’autre nous savons que nous venons d’un monde commun, ni riche ni cultivé, pas du tout celui des lectrices de cet après-midi-là, des dames mûres exsudant la bourgeoisie sûre d’elle et satisfaite. Elles vont fondre sur moi comme des harpies, m’accuser d’être une mauvaise mère et démolir mon livre avec une violence telle que je ne regarderai pas la diffusion de l’émission, en oublierai volontairement tous les détails. Je n’ai retenu que la suite. Au moment où tout le monde va quitter le studio, que, dévastée, je m’apprête à fuir, Claude Duneton me demande si j’ai le temps d’aller boire un pot avec lui. Il émane de son sourire, de ses yeux, son corps massif, quelque chose de chaleureux, solide, « une force tranquille » – je trouverai toujours que la définition mitterrandienne lui allait bien – et je dis oui sans hésiter.
C’est finalement un couscous qu’il m’emmène manger près de la gare du Nord, avec l’amie anglaise venue l’accompagner à l’émission. Il conduit une vieille DS, dont je découvre le confort inégalable de salon sur roues, qui convient, me dit-il, à ses douleurs de hanche. Je lui apprends que c’est aussi mon cas. De ça, on va parler, presque autant que de livres, dans cette brasserie où l’on est restés longtemps. Tous les deux, on a ce point commun d’être des éclopés pour la même raison, une luxation congénitale des hanches découverte trop tard, quand nous commencions à marcher – mais cet enfant boîte, malheur ! – et qu’il nous a fallu passer de longs mois allongés, enfermés dans le carcan d’un plâtre. On en est sortis, réparés, mais pas assez pour ne pas commencer à souffrir et boîter aux alentours de la quarantaine. Cela aussi relève du social, de la vision du monde des parents qui travaillent dur du matin au soir, n’ont pas le temps de « s’écouter », la bonne santé est obligatoire pour eux, pour tous, on n’est pas à l’affût du moindre bobo des enfants en milieu paysan et ouvrier. Et puis la Sécurité sociale alors n’existait pas. Obscurément le corps des classes populaires s’invite dans notre conversation. Claude attribue à l’immobilité forcée de nos premières années le fait que nous soyons devenus écrivains. Quand les autres enfants gambadaient et découvraient le monde autour d’eux, nous étions obligés de l’imaginer. Il faut bien trouver une explication à cette anomalie de s’être échappés des glissières de la reproduction sociale – on ne parle pas de « transfuges » en 1981.
Deux ans et demi ont passé. J’ai publié La Place, le récit de la vie de mon père. Bernard Pivot m’invite à « Apostrophes ». C’est la première fois. Par mon attachée de presse, j’apprends que Claude Duneton propose, pour France Culture, de m’interroger sur la manière dont je vais vivre cet événement, avant et après. Il fera de même avec François Maspero, primo-invité lui aussi. Pas l’ombre d’une hésitation, tout au contraire un sentiment de plaisir et de soulagement, pouvoir exprimer, partager avec quelqu’un en qui j’ai confiance, l’affreuse appréhension qui ne me lâche plus. C’était une idée formidable qu’avait eue Claude. Je n’ai pas retrouvé les cassettes de l’enregistrement mais je me souviens de m’y être épanchée avec une liberté contrastant avec ma détermination presque froide pendant l’émission. À la fois présence rassurante et interviewer sagace, tranquille – oui, encore une fois – il m’a aidée à traverser ce que je considérais comme une épreuve pire que l’oral de l’agrégation. Je le revois me tendant le micro juste avant que je pénètre dans le studio d’Antenne 2. Puis le lendemain, chez Marie-Dominique Arrighi, réalisatrice aussi à France-Culture, nous conviant François Maspero et moi, à un joyeux et passionnant debriefing de notre première expérience d’« Apostrophes ». Une année après, nous voici dans mon jardin, en juin, à Cergy. Il est venu me voir, toujours dans sa grosse DS, avec Isabelle Yhuel, qui partage maintenant sa vie. Dans un mois, je vais me faire opérer, poser une prothèse de hanche, une décision que je me suis résolue à prendre malgré la crainte que m’inspire cette intervention et par-dessus tout l’anesthésie. Claude vient me soutenir, m’encourager et s’encourager lui-même à envisager de passer sur le billard. On rit, on plaisante avec la peur de la mort. Si tu y passes, dit-il, je m’achète un fauteuil roulant pour le reste de mes jours ! – Ne compte pas là-dessus pour te défiler, je vais me réveiller et tu ne pourras plus repousser ton opération ! Isabelle est de mon avis, je sens qu’elle saura le persuader. Effectivement, deux ans après, c’est à mon tour de lui rendre une petite visite à l’hôpital Cochin. Je m’aperçois que, pendant plusieurs années, toutes nos rencontres se sont produites à l’occasion de la réparation de nos corps, qui étaient à la fois jeunes et robustes mais marqués par une pathologie généralement associée aux personnes âgées et avec laquelle il fallait composer quotidiennement, Claude plus que moi, en raison de ses nombreuses activités. En parler ici, c’est, je crois, être fidèle à une vérité des corps, de leur matérialité, de la primauté du vivant que je lis dans ses textes.
Je ne me souviens pas qu’on ait beaucoup abordé le sujet de l’écriture autrement que sous l’angle de ce qui empêche sa pratique. C’est une affaire de pudeur, l’écriture et Claude était pudique. Me revient juste une conversation sur l’impossibilité pour l’un et l’autre d’écrire des livres qui ne reposent pas sur la réalité. Affaire d’origine. De mémoire. Celle inscrite dans les gestes et les paroles des parents, des habitants de Lagleygeolle, son village dont il a ressuscité les 27 jeunes morts de la guerre 14-18 dans le magnifique Monument.
Salut le frère.
Ce texte a été publié initialement dans le recueil ‘Claude Duneton façon puzzle’, dir. Catherine Merle, Gisèle Roy & Pierre Chalmin (Editions Unicité, 2023). Nous le reproduisons et le traduisons ici avec l’aimable permission d’Annie Ernaux. Mis en ligne ici le 29 mai 2024.