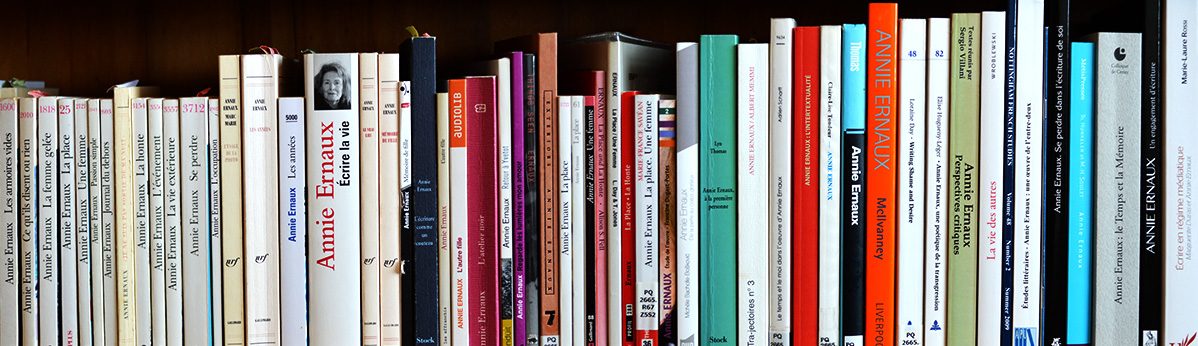Ça a commencé comme ça, avec Jean-Marc Roberts, un livre qu’il m’a envoyé en 1992, Monsieur Pinocchio, son dernier roman, paru à la rentrée précédente. Il y avait une longue dédicace, de cette écriture minuscule que j’apprendrai à reconnaître infailliblement ensuite : Pour Annie Ernaux après avoir passé une bonne partie de la nuit à lire et relire sa « Passion simple » et d’autres mots qui finissaient par Tiens je vous embrasse vous et votre livre qui ne me quittera pas. À ce moment-là, je crois que je n’avais rien lu de lui. Il avait pour moi le visage de l’ange aux cheveux bouclés, écrivain surdoué, qui avait publié à dix-sept ans un premier roman quand, à trente-trois, je doutais d’en faire autant. Que j’avais revu dans l’émission Apostrophes de Pivot, resté mystérieusement impassible face à un exalté furieux vomissant tout ce qui existe (Marc-Edouard Nabe). En lisant Monsieur Pinocchio, je découvrais un roman tendre flirtant avec l’impudeur, au bord du scabreux sans jamais y tomber, comme si cette écriture, fluide, frappait d’innocence tout ce qu’elle touchait, décrivait.
On a mis deux ans avant de se rencontrer. En mai 1994, dans un restaurant proche du Mercure de France où il était éditeur. Ce qui n’avait pas laissé de m’étonner. Je n’imaginais pas Monsieur Pinocchio – ce qu’il restera toujours inconsciemment pour moi- dans cette fonction.
Entre-temps j’avais lu plusieurs de ses livres mais ce n’est pas de littérature que nous avons parlé – et il ne m’a pas demandé de lui « donner » un texte, il était trop fin pour cela – mais de l’Italie. De Venise d’où je rentrais, de la Sicile où il était allé, qu’il me conseillait vivement, et j’irai l’année d’après. Surtout – ce qui sera toujours un sujet entre nous – nous avons évoqué les chansons, la variété française dans laquelle il est tombé tout petit grâce à sa mère, comédienne. Je me souviens que nous avons fait un pari. Il portait sur la date à laquelle était sorti Le Salon du Wurtemberg de Pascal Quignard. J’avais proposé que, si je perdais, ce soit moi qui paierais le prochain déjeuner. J’ai perdu mais il me faudra après batailler plusieurs fois pour qu’il accepte que j’honore mon pari, un midi, dans un restaurant japonais, rue Bernard-Palissy.
Au cours de l’une de ces rencontres annuelles, Jean-Marc m’avait dit avec simplicité, comme en passant, qu’il serait heureux de publier un texte de moi. Sans y revenir ensuite. En 2000-2001, j’avais entretenu un échange par mails avec un jeune écrivain, Frédéric-Yves Jeannet, enseignant alors en Nouvelle-Zélande. Celui-ci, par son questionnement exigeant, m’avait conduite à examiner les tenants et aboutissants de mon travail d’écriture, dans une démarche que je voulais la plus sincère et rigoureuse possible. Je n’avais jamais écrit de textes qui ne soient pas narratifs et c’est cette innovation qui m’a poussée à proposer L’Écriture comme un couteau à Jean-Marc, maintenant éditeur de Stock. Mais au vrai, j’avais peur qu’il refuse, rebuté qu’il serait par ce qui n’était ni un roman ni une autobiographie. Or il a accepté avec un enthousiasme et une générosité qui ne se démentiront jamais. Deux ans après ce livre, il a bien voulu faire traduire et publier l’ouvrage d’une universitaire anglaise, Lyn Thomas, qui traitait de la lecture personnelle que mes textes provoquaient. Un an et demi avant sa disparition, c’est encore lui qui décidera d’éditer les Actes du colloque de Cerisy qui m’avait été consacré. D’où cela d’étrange et d’émouvant de constater, aujourd’hui, que c’est lui, Jean-Marc Roberts, romancier « naturel », éloigné de toute théorie, qui a porté au jour des textes qui ne relèvent pas de la création proprement dite mais de son interprétation. Geste d’un grand éditeur, sans exclusive, ni vue à court terme.
De son travail d’écrivain, il parlait d’une façon pudique et légère, évoquait son désir d’aller plus loin dans la vérité avec chaque livre, d’écrire au couteau, comme il disait. Ce mot était devenu entre nous un mot de connivence, une private joke, qui peu à peu débordera du champ de l’écriture pour s’étendre à celui de la vie, signifiant la résistance à la bêtise, à la méchanceté – dans les derniers temps, à la maladie. Dans un sms, il l’avait brandi avec un point d’exclamation, en défi à une mort qu’il affrontait et dont il refusait la victoire en continuant d’écrire et d’aimer.
Plus de dix ans se sont écoulés depuis que j’ai vu Jean-Marc pour la dernière fois dans ce restaurant du 9e arrondissement où il vivait désormais. Il m’était apparu soudain si grand, à cause du borsalino cachant son crâne mis à nu par la chimio, empreint d’une dignité, presque une majesté romaine, forçant l’admiration et broyant le cœur. Il parlait de la dernière femme dans sa vie, du livre qu’il achevait.
Ce n’est jamais cette dernière image qui surgit spontanément quand je pense à lui, mais une autre, de liesse. C’était à Toulouse, au Marathon des mots, en 2008, le soir. J’avais délaissé le cocktail officiel pour me joindre à la tablée des auteurs et autrices de Stock réunis autour de lui dans une brasserie de la place du Capitole. Un grand repas de famille où l’on mange, boit, rit. Et chante : Jean-Marc s’est levé et il a entraîné la table dans un moment époustouflant de music-hall, passant de Jean-Jacques Debout à Johnny Hallyday, qu’il imitait à merveille. Une remarque éblouie de Pascale Roze, à côté de moi, sur le privilège d’être là et de vivre ce moment, m’avait traversée, comme une soudaine évidence : « La littérature est aussi une fête. » Du moins, c’est ce qu’on pouvait ressentir près de Jean-Marc.
Dans la stupeur et l’incrédulité d’arriver, ce matin glacé de mars au cimetière de Montmartre, après des heures de piétinement, devant la fosse si profonde que les jacinthes apportées depuis mon jardin ont fait en tombant sur le cercueil un bruit de pierres, ce sont les derniers mots d’une chanson qui me sont venus. Celle de Jean Ferrat sur un poème d’Aragon :
Comme une étoile au fond d’un trou.
Texte publié dans ‘« Je vous ai lu cette nuit » : Hommage à Jean-Marc Roberts’ (Paris : Albin Michel, 2023), pp. 75-78, reproduit avec l’aimable permission d’Annie Ernaux. Mis en ligne le 29 mai 2024.